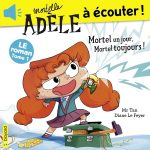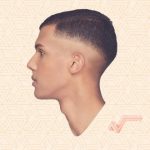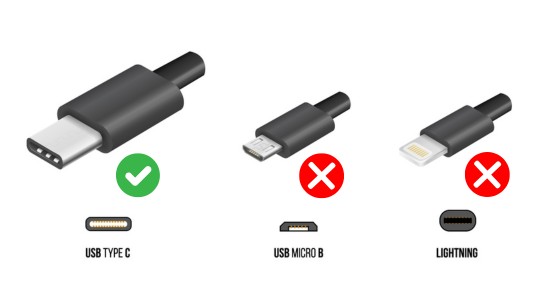Enseignante, blogueuse éducation et passionnée de littérature jeunesse, Lauriane a pour leitmotiv la pédagogie active, notamment par le théâtre, et la lecture pour tous. Retrouver tous ses articles
Les enfants ne sont pas les seuls à pleurer. Ce qui les différencie des adultes tient au fait qu’on les voit tandis que les adultes se cachent le plus souvent. Tous les pleurs n’ont pas les mêmes causes et n’appellent pas les mêmes réponses. L’enfant s’est-il fait mal ? Est-il triste à cause d’une brouille entre amis ? Rencontre-t-il des difficultés émotionnelles ou relationnelles ? Chez les tout-petits, les pleurs sont fréquents et peuvent épuiser les parents qui ressentent alors de la culpabilité. Comment briser ce sentiment d’impuissance ? En se fixant un baromètre et en s’armant de quelques astuces, on peut calmer un enfant qui pleure et lui apprendre à gérer ses émotions.
Comprendre les pleurs de l’enfant
Quelle est la signification des pleurs d’enfant ? Les pleurs font partie du quotidien des familles. Parfois épuisants, ils peuvent aussi s’avérer déconcertants.
Si certains parents culpabilisent et vivent les pleurs de leur enfant comme un échec, d’autres ont tendance à se braquer et à considérer qu’il s’agit d’un caprice. Les recherches en psychologie du développement ont montré pourtant qu’il n’en est rien et que les pleurs ne sont pas non plus un échec éducatif. Ces cris ou murmures mêlés de larmes sont une forme d’expression essentielle à l’enfant pour communiquer ce qu’il ressent. Apprendre à écouter et décoder ce langage émotionnel, c’est l’accompagner dans la construction de soi et l’aider à grandir.
Les pleurs : un langage avant les mots
Avant de pouvoir dire “j’ai faim”, “je suis fatigué” ou “j’ai peur”, le tout-petit pleure. C’est son seul moyen de communication jusqu’à ce que la parole prenne le relais. Selon le pédiatre Donald Winnicott, répondre aux pleurs du bébé construit un sentiment de sécurité intérieure. L’enfant comprend que ses besoins comptent, qu’il est entendu et protégé par ses parents et les adultes qui en ont la charge.
Les pleurs du nourrisson traduisent ses besoins essentiels
Chez le nourrisson, les pleurs traduisent des besoins physiologiques ou affectifs : faim, douleur, inconfort, besoin de bras, de sommeil ou d’attention. Au bout de quelques semaines, les parents savent reconnaître les différents pleurs de leur bébé et lui apporter ce dont il a besoin. Il faut absolument sortir de ce conseil néfaste aux parents qui préconise de laisser pleurer le bébé pour qu’il se calme tout seul, car il n’a pas les ressources physiques et mentales pour le faire. Il a d’ailleurs été prouvé que l’absence de réaction des parents pouvait traumatiser le bébé. Les enfants dont les besoins sont satisfaits pleurent beaucoup moins que ceux qui “patientent” indéfiniment. Au contraire, plongés dans une véritable détresse, ils redoublent de cris et de larmes.
Lorsqu’un nourrisson pleure, la première chose à faire est de le prendre dans ses bras pour le rassurer et vérifier qu’il n’est pas malade. Puis la seconde est de résoudre son inconfort en le nourrissant et en changeant sa couche. Des gestes appris auprès du pédiatre ou de l’ostéopathe pour masser le ventre et soulager la colique permettent de résoudre facilement ces douleurs dues à l’immaturité du système digestif. Il s’agit d’une des causes les plus répandues des pleurs du bébé, avec les douleurs dentaires (on peut aussi masser les gencives avec un gel buccodentaire pour nourrisson).

Les pleurs des enfants de 2 à 6 ans
Vers 2-3 ans, les pleurs deviennent plus émotionnels et se manifestent lors d’épisodes de frustration, de contrariété, de peur, de tristesse ou encore de colère. Autant d’émotions à prendre en compte et dont il convient de discuter avec des mots simples et adaptés avec son enfant.
Enfin, chez l’enfant plus grand, les pleurs peuvent exprimer le stress, la déception, la honte ou l’anxiété, souvent liés à l’école ou aux relations sociales. Encore une fois, il est important de maintenir le dialogue et de chercher à comprendre les causes des pleurs. Elles sont rarement anodines et même si elles se rapportent à des faits sans gravité, elles revêtent aux yeux de l’enfant une importance dont il faut tenir compte quand on l’interroge. Un enfant d’âge primaire considère souvent – à tort – ses propres pleurs comme une marque de faiblesse et se sent en perte de confiance quand elles surgissent. À nous parents de leur montrer qu’il n’en est rien, qu’ils ont le droit de pleurer et d’exprimer leurs émotions. À nous aussi de les accompagner dans la recherche d’une solution qui commence toujours par mettre des mots sur ce qu’on ressent.
Pleurs physiques ou pleurs émotionnels : comment les distinguer ?
Les enfants vivent leurs émotions avec beaucoup d’intensité, même au-delà de 6 ans. Les larmes expriment avec force une difficulté jugée insurmontable par l’enfant. Elles surviennent lorsqu’il ne sait plus comment faire ou comment réagir face à une situation stressante ou anxiogène. L’enfant pleure avant d’aller faire son vaccin, parce qu’il a perdu son ballon, parce que son copain l’a bousculé, parce qu’il voulait un morceau de chocolat et qu’il n’y en a plus… Difficile parfois d’identifier la cause exacte.
Voici quelques repères pour différencier les pleurs physiques des pleurs émotionnels :
- Les pleurs physiques dus à la faim, la douleur, l’inconfort thermique ou encore la fatigue, sont plus soudains, intenses et cessent rapidement une fois le besoin comblé.
- Les pleurs émotionnels découlant d’une accumulation de stress, surstimulation, contrariété ou peur non verbalisée (entrée à l’école, obscurité, changement d’habitude) sont plus longs, parfois irréguliers. Ils s’accompagnent souvent de colère, d’un refus de contact ou au contraire une recherche de réconfort. Par ailleurs, les pleurs de tristesse, plus silencieux et souvent plus douloureux et inquiétants pour l’entourage, expriment un manque (séparation, dispute), une perte (deuil, déménagement), une déception (mauvaise note, défaite au jeu). Seul le dialogue peut en déterminer la cause et déboucher vers une solution.
Bien que désagréables, ces émotions sont pourtant nécessaires au développement psychique. Comme le rappelle la pédiatre Catherine Gueguen, les pleurs participent à la maturation du cerveau émotionnel. Chaque crise de colère et de pleurs est une occasion d’apprendre à réguler ses ressentis, à condition que l’adulte reste un repère stable, calme et bienveillant.

Comment réagir face aux pleurs des enfants ?
Les pleurs d’un enfant peuvent déstabiliser, surtout quand ils semblent disproportionnés ou sans cause apparente. Pourtant, la façon dont l’adulte réagit compte beaucoup dans la stabilité émotionnelle de l’enfant. Le parent n’a pas vocation à “éteindre” les pleurs, mais à accompagner l’émotion qu’ils expriment.
Accueillir les pleurs plutôt que réprimer
Face à un enfant en crise, notre réflexe est souvent de le faire taire rapidement : “Ce n’est rien !”, “Arrête de pleurer !” Ces phrases, dites pour rassurer, peuvent brimer l’émotion, la vider de sens et la réduire à une manifestation “bruyante et désagréable”. Selon la psychothérapeute Isabelle Filliozat, l’enfant n’a pas encore les capacités neurologiques pour gérer seul une émotion intense. Il a besoin de la co-régulation émotionnelle d’un adulte calme et empathique qui l’aide à nommer ce qu’il ressent.
C’est pourquoi il est fondamental de savoir écouter les pleurs de son enfant. Cela montre que le parent reconnait l’émotion – “Je vois que tu es triste / en colère.” Il verbalise la situation en pointant la cause quand elle est connue – “Tu voulais encore jouer, mais il faut partir. Je comprends que ce soit frustrant.” Enfin, l’adulte adopte une attitude d’apaisement qui varie en fonction de l’âge et du tempérament de l’enfant.
Les gestes qui apaisent selon l’âge
Chaque âge a ses besoins et ses repères pour retrouver le calme :
- Bébé (0-2 ans). Le portage, la chaleur du corps, la succion et les gestes lents sont rassurants. De même, la régularité des routines (repas, bain, siestes et coucher du soir) sécurise et contribue à diminuer les pleurs.
- Jeune enfant (3-6 ans). La verbalisation et les rituels d’apaisement (comptines, berceuses, respiration profonde, lecture d’une histoire courte) aident à canaliser la frustration, à déplacer l’attention vers d’autres activités et sources de bien-être. Enfin, le retrait au calme vaut toujours mieux qu’une punition qui ne résout jamais l’instabilité émotionnelle.
- Enfant de 6 à 12 ans. Le dialogue devient essentiel : “Qu’est-ce qui t’a mis en colère ? Que pourrais-tu faire autrement la prochaine fois ?” Encourager à trouver ses propres stratégies de calme : musique douce, dessin, écriture, promenade, écoute d’un podcast.
Dans tous les cas, le parent reste un repère et un modèle pour l’enfant qui observe comment il gère sa propre frustration.

Prévenir les crises de pleurs d’un enfant
La meilleure façon de gérer les larmes est souvent de les anticiper. Les crises surviennent plus fréquemment quand les besoins fondamentaux (sommeil, alimentation, attention, sécurité) ne sont pas satisfaits.
Voici quelques pistes simples pour réduire les tensions au quotidien :
- Préserver un rythme stable : des horaires réguliers favorisent la sérénité.
- Limiter la surstimulation : après l’école, éviter d’enchaîner les activités ou les écrans.
- Anticiper les transitions : prévenir avant un changement (“Dans 5 minutes, on range et on part”) aide l’enfant à se préparer.
- Encourager l’autonomie : donner des choix limités (“Tu veux mettre le pull rouge ou le bleu ?”) redonne du contrôle et diminue les frustrations.
- Valoriser les progrès : féliciter les efforts (cadeau émotionnel), pas seulement les réussites.
Une fois que la crise est là, le premier réflexe doit être de proposer à l’enfant un espace neutre pour retrouver le contrôle de lui-même. Par exemple, si vous êtes dans le bus ou en voiture, il est préférable de descendre prendre l’air et mettre la situation à plat. L’environnement peut vite s’avérer oppressant pour vous et l’enfant. Les esprits retrouvent plus facilement leur calme dans un contexte dénué de contraintes. Ensuite, prendre son enfant dans ses bras, même lorsqu’il a 4 ou 5 ans, permet de recoller symboliquement ce que la colère a dispersé. Ce geste d’apaisement du parent envers l’enfant réactualise le lien d’affection, rassure, réconforte et prépare l’étape suivante de la parole et du retour à la normale.

Aider l’enfant à apprivoiser ses émotions
Les larmes font partie de la palette d’expression des émotions. En apprenant à mieux gérer les sensations et sentiments qui l’assaillent l’enfant se calme plus rapidement. L’objectif n’est pas de supprimer les pleurs qui ont une fonction bien précise de communication avec l’entourage, mais plutôt d’aider l’enfant à se sentir mieux.
Un espace pour retrouver son calme
Aider un enfant à se calmer c’est d’abord lui proposer un cadre apaisant pour le faire. À l’écart du bruit et de l’agitation et loin des regards indiscrets, il peut prendre le temps dont il a besoin pour respirer lentement et verbaliser son ressenti. De même, les routines et espaces dédiés au calme à la maison ou à l’école fonctionnent comme des sas de récupération émotionnelle. L’enfant sait par exemple qu’après le déjeuner, il va pouvoir se détendre sans agitation autour de lui. Un moment indispensable pour mettre à distance les désagréments éventuels de la matinée et affronter plus sereinement le reste de la journée.
Respiration, relaxation, méditation… des exercices pour s’apaiser
Pour accompagner l’enfant dans ces temps calmes, rien de tel que la respiration profonde, la relaxation, la sophrologie, le yoga ou encore la méditation. Toutes ces activités se complètent et s’adaptent aux besoins de l’enfant. Elles permettent la détente musculaire et diminuent le stress et les angoisses. Prendre ce temps en famille apporte des bienfaits immédiats pour les petits comme pour les grands. De même, la musique douce invite l’enfant à s’évader dans une bulle rassurante et relaxante. En seulement quelques minutes d’écoute d’une berceuse, chanson douce ou encore bruits de la nature, l’enfant quitte sa colère et sa tristesse pour renouer avec sa bonne humeur et son entrain habituels.
Les histoires favorisent la régulation émotionnelle
Enfin, l’enfant peut apprendre à mieux gérer ses émotions en s’appuyant sur des modèles. Le premier modèle est bien sûr celui de ses parents dont il évalue les réactions. Un adulte qui reste calme, se montre compréhensif et sait guider l’enfant vers la résolution de ses conflits est un modèle de gestion émotionnelle. Pour compléter ces informations, l’enfant peut aussi recourir à des supports comme les livres ou les histoires audio. De nombreux personnages passent par des tempêtes émotionnelles et montrent diverses façons de les surmonter. L’enfant peut s’identifier à eux, vivre symboliquement leurs épreuves et s’appuyer sur cette expérience pour affronter le réel.

Quand s’inquiéter face à des pleurs persistants ?
Quand faut-il consulter ? Des pleurs incessants, inconsolables ou associés à un changement de comportement (troubles du sommeil, perte d’appétit, isolement) justifient un avis médical — pédiatre ou pédopsychiatre. Seul un médecin est à même d’évaluer la gravité d’un symptôme et d’en identifier la cause. Sans être spectaculaires, une chute ou un coup peuvent entraîner un traumatisme (fracture, entorse, déchirement musculaire, etc.) et une pathologie bénigne évolue parfois vers des symptômes plus sévères (surinfection, sinusite, déshydratation, etc.).
Lorsque les causes physiques sont écartées et que les pleurs reviennent sans cesse, sans raison apparente ou immédiatement compréhensible, n’hésitez pas à consulter un spécialiste de la santé mentale. Les PMI, centres médico-psychologiques, structures publiques et associatives spécialisées enfants accueillent les enfants présentant des troubles du comportement, anxiété et dépression et soutiennent les familles dans leur quotidien. Renseignez-vous auprès de votre mairie et de votre médecin pour connaitre l’offre de soins à proximité de votre domicile.
Accueillir les pleurs d’enfants sans les blâmer et donner les clés pour mieux gérer ses émotions participe au développement psycho-affectif de l’enfant. En restant à l’écoute et en proposant des activités de détente et de calme adaptées à l’âge de son enfant, on favorise son bien-être et son épanouissement.
Et vous, quelles sont vos astuces et conseils pour faire face aux pleurs de vos enfants ? Si vous voulez partager votre expérience, rendez-vous sur nos réseaux Facebook et Instagram !


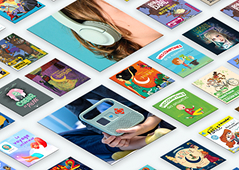
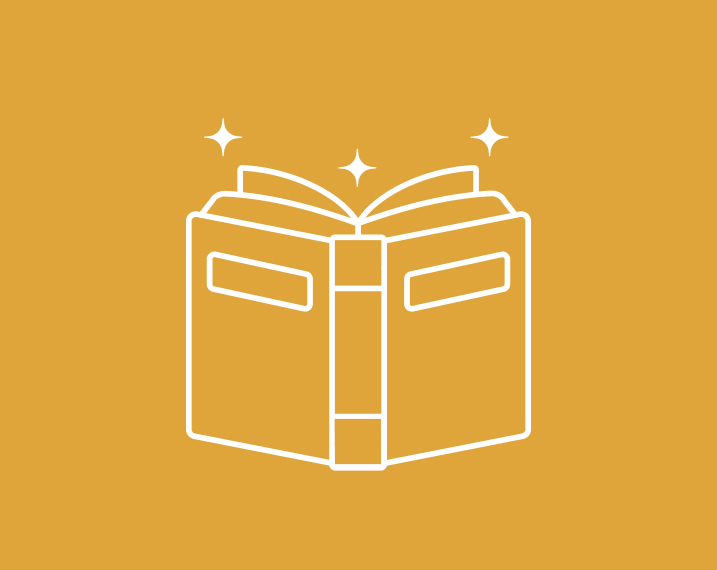 Les histoires
Les histoires Les documentaires
Les documentaires La musique
La musique Le calme
Le calme